Publication en août 2025
Cet article est inspiré d’une vidéo de la chaîne américaine Youtube « Iron Pulse ».
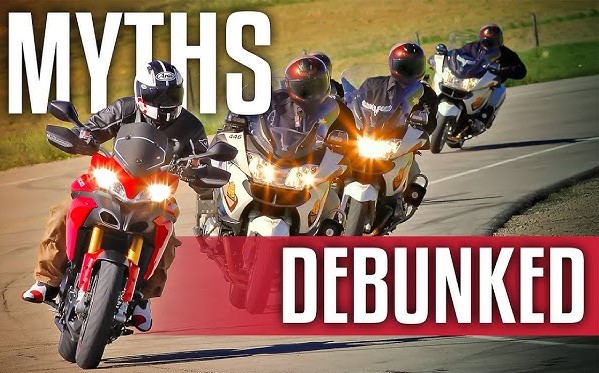
Sommaire de l'article
Introduction
Dans ma carrière motarde, j’ai appris à mieux rouler à moto avec des gendarmes et des policiers, avec des civils et avec des sportifs, sur la route, en tout-terrain et sur circuit. Et si j’ai appris une chose, c’est que tous ces motards ont des dogmes, des idées formatées, des clichés, des préjugés… reproduits et transmis de génération en génération.
Ces idées reçues proviennent souvent de vérités qui ont été avérées en un autre temps ou valables dans un autre environnement :
- beaucoup ont été vraies.. du temps du moteur à 2-temps et/ou à carburateurs, il y a plus de 20 ou 30 ans
- d’autres (ou les mêmes) sont dérivées, copiées du monde de la compétition, mais non applicables à la moto de route
Je rencontre fréquemment l’argument du « on a toujours fait comme ça, donc c’est bien », y compris dans mon métier de formateur moto où je côtoie des collègues et confrères qui possèdent 20 ou 30 ans d’expérience dans la profession. Je leur réponds que si on appliquait ce principe, nous en serions encore à nous balancer de liane en liane dans la jungle…
Dire « on a toujours fait comme ça, donc c’est forcément bien, donc on continue » est la négation de la notion même de progrès.
C’est Monica Bellucci qui le dit, donc c’est forcément vrai… 😉
Tout ça pour dire qu’il faut savoir prendre du recul sur sa pratique, analyser, tirer les leçons du passé et en dégager des enseignements pour un meilleur avenir.
Coucher la moto quand on chute
Certains motards croient que, lors d’une chute à moto, il faut laisser partir la moto, la coucher, la faire glisser, ne pas rester dessus… La théorie qui sous-tend cette idée serait le fait de glisser au sol serait moins traumatisant, engendrerait des lésions moins graves, que d’aller taper un obstacle en restant solidaire de la moto.
Et en théorie (ce fameux pays où tout se passe comme prévu)… ça semble être une bonne idée !
Sauf que dans les faits, en pratique (un autre pays où rien ne se passe comme prévu)… vous n’avez aucun moyen de le savoir à l’avance.
Tout d’abord, une chute à moto, une perte d’adhérence, ça se joue en dixièmes de seconde, grand maximum une seconde. Votre seul temps de réaction biologique, le temps que ça prend de comprendre ce qui se passe (quand c’est imprévu) et de commencer à réagir, est déjà de l’ordre d’une seconde à 1,5 seconde. Vous n’avez juste pas le temps de réfléchir.
Pour l’avoir vécu, les trois fois où je suis tombé sur route à cause d’une perte d’adhérence de l’avant (ou des deux roues en même temps), je me suis retrouvé au sol en un clin d’oeil, sans comprendre ce qui m’arrivait. Alors penser à une stratégie, à une façon de gérer la chute… même pas en rêve !
Ensuite, une chute sur route, hors circuit, prend place dans un environnement non maîtrisé.
Sur circuit, c’est « facile », vous savez qu’il n’y aura pas d’obstacle, que vous allez pouvoir vous laisser glisser sur le dos et/ou les fesses, et que ça va finir par s’arrêter soit dans un bac à graviers, soit au bord d’une piste qui mesure 9 à 12 mètres de large.
Sur route, sur des départementales qui mesurent 6 mètres de large avec sur les côtés des rambardes, des ravins, des murets, des arbres, des falaises, pire encore en ville avec des bordures de trottoir et des poteaux, vous ne savez pas quels obstacles peuvent être présents, de quoi est exactement composé l’environnement juste là où vous allez glisser.
Vaut-il mieux se désolidariser de la machine ou rester avec elle en la plaçant entre vous et l’obstacle ? Impossible de le savoir à l’avance et sur le moment, ça se joue très très vite…
Une de mes dernières chutes (en 2017), où j’ai perdu l’avant sur du sable sur une petite route, à 30-40 km/h en virage à gauche, je me suis retrouvé à glisser sur le dos vers le bord de la route, j’ai eu une fraction de seconde pour regarder là où j’allais, voir qu’il y avait un rail métallique et lever les pieds pour m’appuyer dessus et ne pas passer en-dessous. Cela s’est passé très vite et encore, je ne roulais pas à grande vitesse, ce qui a fait que je n’ai pas glissé vite et m’a laissé le temps de voir où j’allais.
Sur une chute à 50 ou 80 km/h, je ne suis pas du tout certain que j’aurais eu ce temps.
Enfin, cette apparente « bonne idée » dépend des circonstances, de l’environnement, mais aussi de la machine avec laquelle vous roulez.
Sur la plupart des motos, vous aurez plutôt intérêt à ne pas rester en selle, afin de ne pas laisser la jambe sous la moto, coincée entre le bitume abrasif et une machine de 200 kg avec d’un moteur chaud, de pièces métalliques saillantes et parfois coupantes, de pots d’échappement brûlants, d’une chaîne métallique qui tourne à grande vitesse et découpe tout ce qui se passe à sa portée…
A l’inverse, si vous roulez sur une moto équipée de larges valises latérales, de barres de protection, voire d’un moteur bicylindre à plat, qui protègent vos jambes et permettent de ne jamais rester coincé sous la machine quand elle chute… il s’avère souvent préférable de rester dessus.
Et surtout, tout cela ne s’applique que quand vous tombez, quand la moto a vraiment perdu l’équilibre.
Rouler avec l’idée en tête de « sauter de la moto » dès que vous avez l’impression que vous commencez à perdre le contrôle… c’est renoncer d’avance, vous exposer à des chutes que vous auriez pu rattraper et vous faire dépenser une fortune en réparations.
Les pneus et les freins ont réalisé d’immenses progrès techniques sur les 20 dernières années, ce qui autorise des prises d’angle et des freinages bien plus efficaces qu’avec la bécane de votre grand-père. Les motos modernes (disons, de moins de dix ans d’âge) comprennent pour la plupart des assistances à la conduite (freinage ABS, anti-patinage, contrôle de traction etc.) qui permettent de rattraper des situations qui auraient pu mal finir avec une machine des années 1990 ou 2000.
Des « presque accidents », des débuts de pertes d’adhérence, des commencements de pertes d’équilibre, on en vit plein sur toute une vie de motard ! On ne va pas « abandonner le navire » dès que ça commence à mal se passer.
Laisser chauffer le moteur à l’arrêt pendant 5 ou 10 minutes
Laisser tourner le moteur à l’arrêt pendant au moins cinq minutes, parfois dix, voire plus, surtout en hiver, pour faire chauffer le moteur avant de partir rouler… Vous l’avez très probablement déjà entendu ou vu faire !
Pourtant… c’est une mauvaise idée.
Faire tourner à l’arrêt un moteur froid, c’est ne faire chauffer que le bas moteur et favoriser la condensation, c’est-à-dire la transformation de vapeur d’eau (qui pourrait s’échapper avec les gaz d’échappement) en gouttelettes d’eau liquide qui vont aller corroder les tubes d’échappement et se mélanger à l’huile moteur pour la dégrader et former la fameuse « mayonnaise », ce qui favorise la création de calamine, ces dépôts d’huile brûlée qui pénalisent la performance du moteur…
Bref, cela ne sert à rien de bien et en plus, vous brûlez de l’essence pour rien.
Les moteurs « modernes » (à partir des années 2000, environ) sont gérés par un calculateur d’injection électronique, avec un ECU (Engine Control Unit) qui gère la richesse du mélange air/essence, avec une sonde dite « lambda » qui analyse en temps réel la composition et la température des gaz d’échappement…
Pas besoin de faire chauffer le moteur à l’arrêt : l’ECU s’en occupe, en roulant !
Même en hiver, laissez chauffer 30 secondes à une minute, juste le temps de finir de vous équiper et de fermer vos poches… et allez rouler !
Mais doucement.
Laissez le temps de chauffer au moteur et aux pneus, surtout quand il fait froid.
Cela prend en général plusieurs minutes.
En savoir plus : Gaffe aux pneus froids !
Pour éviter d’autres erreurs mécaniques :
Deux vidéos de vulgarisation mécanique pour mieux comprendre :
Les pots bruyants, c’est pour la sécurité
Une partie des motards anglophones a coutume de dire (et de penser) que « loud pipes save lives« .
Hélas, ce n’est pas parce qu’un slogan sonne bien qu’il s’avère forcément fondé.
Les pots bruyants ne sauvent pas des vies.
C’est un mythe, au mieux une erreur, au pire un mensonge.
Tout d’abord, le grand argument de la sécurité s’avère assez amusant dans la mesure où on observe facilement que les motos les plus bruyantes sont les plus accidentogènes (surtout les sportives) et celles qui sont conduites de la façon la moins sûre.
L’explication donnée par une bonne part des motards urbains qui mettent un pot adaptable, voire non homologué, est qu’ils seraient ainsi mieux entendus, mieux perçus par les automobilistes… surtout quand ils remontent les files de façon quasi suicidaire.
Bizarrement, cela ne les choque pas que les motos les moins bruyantes (BMW, Goldwing, routières japonaises, trails) soient aussi les moins accidentogènes, les moins représentées dans les accidents, notamment mortels.
Examinons les choses de façon rationnelle.
Pour que le bruit d’une moto puisse vous sauver la vie, le bruit des échappements doit être audible par le conducteur dans la voiture. Logique !
Le bruit de la moto doit donc être supérieur au niveau du bruit de fond dans la voiture, du bruit généré par le moteur, de la musique, des conversations et des bruits aérodynamiques et du bruit de frottements des pneus sur le revêtement lorsque la voiture roule…
Tout dépend ensuite de la vitesse de circulation de la voiture !
Pour avoir un effet, le bruit de la moto doit attirer l’attention.
Il doit être suffisamment fort et être entendu lorsque la moto est suffisamment éloignée pour que le conducteur de la voiture puisse réagir, soit deux à trois secondes en avance.
A 50 km/h, une moto parcourt déjà 14 mètres par seconde…
Pour être perçue au moins deux secondes à l’avance à une distance audible de 15 mètres en arrière de la voiture, une moto devrait rouler à moins de 20 km/h…
La direction du son
N’importe quel crétin peut observer que la sortie d’échappement de tout véhicule (à moteur thermique à combustion interne) pointe vers l’arrière. Plus ou moins vers le haut ou vers le bas, le plus souvent à l’horizontale… mais toujours vers l’arrière du véhicule, et notamment d’une moto.
Le même abruti congénital peut également constater que ce même véhicule est conçu pour se déplacer vers l’avant, particulièrement s’agissant des motos dont très peu de modèles possèdent une marche arrière.
En résumé, une moto émet du bruit vers l’arrière tout en roulant vers l’avant.
Autrement dit, le son est émis à l’opposé de la course de la moto, ce qui gêne considérablement sa perception par les usagers se trouvant devant la moto.
Les motards bruyants citent souvent en exemple les sirènes des véhicules d’urgence, qui annoncent leur arrivée et les aident à se frayer un passage dans la circulation.
Et c’est d’ailleurs bien pour cela que les avertisseurs sonores des véhicules de police / gendarmerie / pompiers / ambulances sont TOUS (absolument tous) orientés vers L’AVANT !!!
Prêtez-y attention la prochaine fois que vous croisez un véhicule toutes sirènes hurlantes : vous l’entendez arriver de loin, mais dès qu’il vous a dépassé, on l’entend beaucoup moins bien.
Pour que le bruit de la moto soit suffisamment élevé pour être perçu vers l’avant, il devra être tellement fort vers l’arrière qu’il constituera une agression pour ceux qui se trouvent derrière et reçoivent le son en direct.
La réverbération du son
Quand on émet l’évidence détaillée ci-dessus, les tenants des pots bruyants ont un argument bien rodé : « mais pauvre imbécile, tu ne connais donc pas les règles physiques de la propagation du son ? »
Comme la plupart d’entre nous ne sommes pas ingénieurs acousticiens (et moi non plus), nous acceptons cet argument soi-disant « scientifique ». Sauf qu’eux non plus ne sont pas acousticiens… Et que moi, j’ai creusé un peu le sujet.
Les règles physiques de propagation des ondes sonores font que l’essentiel des émissions sonores se fait dans la direction de la sortie du silencieux d’échappement.
Contrairement à ce que croient beaucoup, les ondes sonores se diffusent de manière conique, et non sphérique. C’est bien pourquoi, lors d’un contrôle d’intensité sonore, le sonomètre doit être placé à hauteur de la sortie du pot d’échappement, et non devant la moto ou sur les côtés.
Le bruit se diffuse dans un cône dont la pointe se situe à la sortie du pot.
Les ondes se répercutent ensuite sur toute surface solide qu’elles heurtent, en perdant progressivement de leur intensité à mesure qu’elles parcourent un milieu fluide, gazeux (comme l’air) ou liquide.
Si l’onde sonore ne rencontre aucun obstacle, si elle ne se répercute pas sur une surface solide perpendiculaire à sa source d’émission, elle continuera à se propager en s’atténuant sur la distance, l’atténuation dépendant de nombreux paramètres (pression atmosphérique, densité de l’air, etc.).
C’est aussi une conséquence de l’effet Doppler.
Dans le cas d’une onde sonore, « la perception de la hauteur du son d’un moteur de voiture ou de la sirène d’un véhicule d’urgence (…) est différent selon que l’on se trouve à l’intérieur du véhicule (l’émetteur étant immobile par rapport au récepteur) ou que le véhicule se rapproche du récepteur (le son étant alors plus aigu) ou s’en éloigne (le son étant plus grave). »
Avant que la moto n’arrive à la hauteur d’une voiture, le son perçu par l’automobiliste est déformé, souvent moins facilement perceptible.
De plus, la variation de la fréquence de l’onde sonore affecte sa capacité à se propager dans l’espace.
Pour que l’onde sonore soit répercutée avec un niveau suffisant d’intensité vers l’avant, dans la direction du déplacement de la moto et donc dans la direction opposée à la source d’émission sonore, cette onde devra :
- non seulement rencontrer des surfaces solides (comme des véhicules, des murs),
- mais aussi posséder une intensité de départ suffisamment forte pour rester perceptible à plusieurs dizaines de mètres en amont de la moto par des usagers (parfois perturbés dans leur audition).
Le problème est que cette très forte intensité de départ ne varie pas dans le temps et dans l’espace.
Résultat : pour se faire entendre dans les bouchons (soit sur 5 à 10% de sa vie, de son kilométrage total), une moto émet un son tellement puissant qu’il en devient agressif pour toutes les personnes dans son environnement pendant les 90 ou 95% restants, soit l’essentiel de son temps d’usage.
Le rôle du différentiel de vitesse
Une moto bruyante sera peut-être mieux entendue sur la route… mais seulement si elle roule assez lentement pour laisser le temps aux autres usagers de la route de l’entendre arriver, de la détecter et de réagir.
Ce qui est impossible quand on arrive avec 40 km/h (voire plus) de différentiel entre la moto et les voitures.
Le rôle de l’isolation phonique des voitures
Faire du bruit pour être détecté suppose que l’autre usager soit en état de vous entendre arriver.
Donc que l’automobiliste n’ait pas mis son autoradio à fond, qu’il ne soit pas en train de téléphoner, qu’il ne soit pas malentendant, qu’il ne soit pas en train de parler, etc.
Sans parler du niveau d’isolation phonique des habitacles qui a beaucoup progressé, notamment pour éviter aux automobilistes les nuisances du bruit des moteurs diesel.
Un automobiliste peut très bien se trouver « distrait », gêné dans sa perception auditive des bruits extérieurs par tout un tas de facteurs, dont je donne quelques exemples ci-dessus.
Même si les autres conducteurs sont bien sages derrière leur volant sans perturbation sonore, les progrès techniques dans l’isolation phonique des habitacles des automobiles font qu’il n’entendront pas la moto arriver, ou alors très tard.
Nous-mêmes à moto, combien de fois avons-nous été surpris par une moto arrivant à bloc derrière nous, à sursauter quand elle nous dépasse ?
Plus la cylindrée est importante, plus la moto roule vite
Encore un slogan américain infondé : « bigger is better » !
Si c’était vrai, les gros customs Harley et Indian, avec des moteurs de plus de 1600 cm3, seraient les motos les plus rapides du monde.
On sait bien que ce n’est pas le cas.

Si c’était vrai, la moto thermique de série avec la plus grosse cylindrée, c’est-à-dire la Triumph Rocket III avec son moteur de 2400 cm3, détiendrait le record du monde de vitesse.
Or il s’agit de la Kawasaki Ninja H2R, qui « cube » seulement 1000 cm3 (mais avec un moteur turbocompressé)…
Mieux encore, le record du monde de vitesse de pointe par une moto homologuée pour la route est actuellement détenu par une moto électrique (Lightning LS-218) !
La vitesse de pointe à moto, ce n’est pas qu’une question de cylindrée, ni même de puissance.
C’est une équation complexe entre la puissance moteur, le poids du véhicule (rapport poids/puissance) et son aérodynamisme.
Rappelez-vous qu’un moteur de 125 cm3 suffit pour dépasser les 170 km/h… sur une Cagiva Mito préparée, hyper légère (moins de 110 kg) et avec une aéro étudiée au millimètre.
Sur une moto de route, plus de cylindrée offre plus de couple, de meilleures accélérations… mais au prix d’un important surcroît de poids, donc de consommation d’essence.
Pour en savoir plus, lire Eloge des motos de moins de 500 cm3
L’essence la plus chère donne de meilleures performances
Une croyance assez répandue voudrait que les carburants avec un indice d’octane plus élevé, vendus plus cher, offrent de meilleures performances à la moto.
C’est plus compliqué que ça…
L’indice d’octane est une mesure de la résistance du carburant à l’auto-allumage dans le moteur.
Plus précisément, il indique la capacité du carburant à résister au cliquetis, un phénomène indésirable qui se produit lorsque le mélange air-carburant s’enflamme spontanément avant l’étincelle de la bougie d’allumage. Le cliquetis peut endommager le moteur s’il n’est pas maîtrisé, c’est pourquoi l’indice d’octane est important.
Mais cela ne joue pas dans la « réponse moteur » !
Aucune influence sur le couple ou la puissance du moteur. Ce qui peut jouer par contre, c’est la présence plus ou moins grande d’additifs dans le carburant, qui vont permettre une meilleure combustion, donc moins de gaz imbrûlés, donc moins d’émissions polluantes et moins d’encrassement du moteur.
Encore faut-il que le moteur de votre moto ait été optimisé pour un certain type de carburant…
C’est précisé dans la notice d’utilisation.
Si votre machine n’a pas été spécifiquement prévue pour du SP98, il est inutile de lui donner que ça. Elle fonctionnera tout aussi bien au SP95.
Par contre, évitez de faire régulièrement le plein au SP95 E10 : ce n’est pas l’indice d’octane qui pose problème, mais la présence de 10% d’éthanol dans l’essence.
Pas la peine de s’équiper pour les trajets courts
« Je vais pas loin », « j’en ai pour 5 minutes »… donc juste casque et gants. Le reste ? La flemme…
C’est oublier que, selon la dernière étude menée par Liberty Rider sur plus de deux milliards de kilomètres analysés, plus de 30% des accidents impliquant au moins un motard se produisent dans les 15 premières minutes du trajet et 40% ont lieu dans les 10 premiers kilomètres.
Les accidents, les chutes et leurs conséquences sont les mêmes, quelle que soit la machine, le jour ou la distance par rapport à votre point de départ.
Ce qui joue, c’est la vitesse d’impact, votre degré de vigilance et de concentration, l’adhérence du revêtement, votre capacité d’observation et d’analyse de situation, la visibilité, la saillance visuelle… Tous ces facteurs vont bien intervenir comme cause(s) d’accident et/ou dans le degré de gravité de l’accident.
Mais pas la distance parcourue !
Si vous vous dites ça, c’est pour vous donner bonne conscience, pour vous mentir à vous-mêmes. C’est votre droit. Mais soyez bien conscients que cela ne présente aucun fondement rationnel.
Pour une fois, un slogan américain est pertinent :
ATGATT, pour « all the gear, all the time » (tout l’équipement, tout le temps).
Pour en savoir plus, lire :
- Optimiser sa visibilité à moto (1/2)
- Optimiser sa visibilité à moto (2/2)
- Se conduire en “vrai pilote”
- Se conduire en motard responsable
- Ce que « anticiper » veut dire (en conduite moto)
La graisse de chaîne, ça dure longtemps
Il est amusant de voir combien de motards disent mépriser le cardan et la courroie, ne jurer que par la chaîne de transmission secondaire, n’hésitent pas à dépenser leur argent une chaîne « renforcée »… mais ne se donnent pas la peine de bien l’entretenir !
La transmission secondaire de votre moto, c’est son artère aorte, celle qui part du coeur (le moteur) pour apporter le sang, l’énergie, au membre en mouvement (la roue arrière). Et vous pensez qu’un graissage une ou deux fois par an suffit pour qu’elle fonctionne bien ?!?
La chaîne et son lubrifiant subissent les agressions de l’eau, des poussières, des projections, de toutes les impuretés déposées sur la route et soulevées par vos pneus. Si la chaîne n’est pas entretenue, dégraissée, nettoyée, lubrifiée régulièrement (tous les 500 à 1.000 km), elle s’abîme, se dégrade, se détend… ce qui pénalise vos accélérations, mais aussi la consommation de carburant.
Vous n’auriez pas l’idée de rouler avec un moteur sans huile…
Alors pourquoi rouler avec une chaîne sans graisse ?
Pour en savoir plus, lire :
Tendre et lubrifier sa chaîne en restant détendu
Pourquoi cette tyrannie de la chaîne ?
Le frein moteur endommage la mécanique
Certains motards (même certains formateurs moto) proscrivent les ralentissements au frein moteur. C’est le frein avant ou rien !
Décélérer, voire rétrograder (proprement), n’abîme aucunement votre bécane.
Encore faut-il évidemment le faire correctement ! Rentrer un rapport brutalement à 10.000 tr/min., ça va faire mal…
Le simple fait de couper les gaz permet de ralentir doucement, de façon linéaire et contrôlée.
Ce n’est certes pas le freinage le plus efficace, mais cela permet de ralentir sans perturber l’assiette de la moto.
Rétrograder, en débrayant de préférence, si possible avec coup de gaz, en relâchant le levier d’embrayage en souplesse, sans brusquerie, permet de synchroniser la chaîne cinématique, d’accorder la vitesse de rotation du moteur avec celle de la roue arrière, afin de rester dans la plage de régimes efficace pour votre moto, et donc d’éviter le sous-régime… qui lui est bien destructeur pour le moteur et la transmission !
Lors de freinages prolongés ou répétés à courts intervalles (en descente de col, par exemple), le frein moteur permet de moins solliciter le frein avant, donc de moins user les plaquettes et surtout d’éviter un échauffement excessif des disques, puis du liquide de frein… donc d’éviter le risque de « fading » (quand le liquide de frein approche de sa température d’ébullition et perd sa capacité de compression).
Pour aller plus loin :
- Le rétrogradage avec coup de gaz
- Les idées fausses sur le freinage à moto
- Le changement de rapports « à la volée »
Il faut poser les deux pieds au sol à l’arrêt
Vouloir absolument poser les deux pieds au sol à chaque arrêt… n’est pas toujours une bonne idée en termes de sécurité et de préservation de son équilibre.
Vous avez peut-être l’impression que cette position statique avec les deux pieds posés, qui rappelle la position debout en équilibre, assure votre stabilité. Mais une moto à l’arrêt complet, bloquée avec un frein (avant ou arrière), est en équilibre, même avec un seul pied au sol : pneu avant + pneu arrière + un pied = triangle de sustentation.
Avec les deux pieds au sol, si un des deux pieds perd l’adhérence, vous ne pourrez pas rattraper la moto. Avec les deux pieds au sol et si vous êtes au point mort, vous allez mettre du temps à enclencher la 1e pour dégager en cas d’urgence.
A vouloir toujours poser les deux pieds au sol, vous n’apprenez pas à vous adapter en cas de route en dévers et vous aurez bien plus de difficulté à démarrer en côte.
Pour aller plus loin :
- Savoir si on est un motard débutant (ou pas)
- Gérer l’équilibre à l’arrêt
- Redresser une moto sans effort
- Démarrer en côte
Passer le point mort pour économiser de l’essence
C’est une idée reçue qu’on entend parfois : passer au point mort permettrait de consommer moins d’essence (à moto comme en voiture).
Cela démontre juste une profonde méconnaissance du fonctionnement d’un moteur thermique à injection.
A partir du moment où vous coupez les gaz, où vous lâchez complètement l’accélérateur, quel que soit le rapport engagé, l’ECU injecte une toute petite quantité de mélange air/essence (quelques millilitres par minute) dans les chambres de combustion, juste de quoi faire tourner le moteur pour qu’il ne cale pas.
Le fait de passer le point mort ne change absolument rien.
Le fait de rouler ou non ne change rien.
Etre en roue libre ou embrayé ne change rien (sur du plat).
Coupure des gaz = consommation minimale, même avec un rapport engagé.
Mes stagiaires savent que c’est un de mes petits « combats personnels » : lutter contre cet impératif du rapport « neutre » dès qu’un motard s’arrête, que ce soit à un feu rouge, à un stop, pour un arrêt bref ou un stationnement prolongé.
Pour en savoir plus : Réflexions sur le point mort et la roue libre
Pour découvrir d’autres mythes et préjugés du monde motard, une vidéo francophone :
Juste deux petites erreurs de frappe :
Dans « Coucher la moto quand on chute », « certains motards (croisent) que… »
Et dans « Passer le point mort pour économiser de l’essence », « mes stagiaires (avent) que… »
Voilà, voilà… Sinon merci pour ce très bon article, comme toujours !
Corrigé, merci !