Trouver une piste d’entraînement constitue souvent une difficulté pour une école moto. Quels sont les problèmes que pose cette infrastructure indispensable et les solutions pour proposer une formation de qualité ? Nous avons enquêté auprès des professionnels du secteur.
Cet article a été originellement publié dans la revue professionnelle “La Tribune des Auto Ecoles”, édition de mai 2025, mais dans une version “édulcorée” pour ne pas déplaire aux syndicats professionnels des exploitants d’écoles de conduite. Je le publie ici in extenso, tel que je l’avais rédigé à l’origine.

Sommaire de l'article
Introduction
La piste d’entraînement constitue un outil de travail indispensable pour les écoles de conduite moto en France, au nombre de 5.948 recensées à ce jour par le registre national RAFAEL.
Indispensable, mais pas obligatoire : rien dans les textes réglementaires ou dans l’agrément préfectoral n’impose la présence d’un espace de travail hors circulation pour les différentes formations à la conduite des véhicules à deux et trois roues motorisés, à la différence des formations pour le groupe lourd.
Le « label qualité moto », aujourd’hui décerné à 2.808 établissements (soit moins de la moitié des moto-écoles déclarées), s’avère à peine plus exigeant : il suppose d’une part de justifier de l’accès à une piste aux dimensions prévues pour l’examen, d’autre part de fournir aux élèves les informations sur l’emplacement, le temps de trajet depuis l’agence et la capacité d’accueil de la piste.
En théorie, les délégués et inspecteurs au permis de conduire sont habilités à vérifier si la piste correspond aux informations transmises dans le cadre du label et si elle permet de respecter le programme de formation. Dans la réalité, ces contrôles, comme les autres inspections pédagogiques, ne sont pas effectués, faute de temps et de moyens humains disponibles.
Quand bien même ils le seraient qu’ils ne concernent que les aspects purement réglementaires (dimensions de 130 mètres de long par 6 mètres de large, avec le tracé des épreuves) : aucune obligation concernant l’état du revêtement de la piste, ni sa sécurisation, ni son environnement.
Avec ou sans label qualité, rien n’oblige aujourd’hui une école de conduite moto en France à disposer d’une piste – encore moins d’une piste en bon état – pour commercialiser des formations moto (et apparentées).

Conséquences concrètes
Chaque année, des dizaines de milliers d’élèves s’initient à la moto ou au scooter, découvrent ce type de véhicule à deux roues non carrossé, sans ceinture de sécurité ni airbag ni doubles commandes, sur des « pistes » à peine dignes de ce nom.
En l’absence de contrôles comme d’enquêtes de terrain sur les milliers d’aires de formation à travers le territoire, il est difficile d’évaluer avec précision la proportion d’écoles de conduite moto qui font travailler leurs élèves sur des aires d’évolution non sécurisées, parfois ouvertes à la circulation, comme des zones de stationnement de cinémas, de discothèques, de salles de spectacle, de stades, de palais des congrès ou de parcs des expositions, mais aussi parfois des routes désaffectées ou d’accès à des usines.
Beaucoup de moniteurs moto ont constaté que certaines aires s’avèrent plus ou moins constellées de trous et/ou de bosses, parfois entourées de bordures, de murets ou de fossés qui constituent autant d’obstacles gênants, voire dangereux.
D’autres lieux (ou les mêmes) ne respectent pas les dimensions minimales réglementaires, notamment en largeur, ce qui cause des problèmes de sécurité pour des élèves débutants qui doivent effectuer des demi-tours particulièrement serrés et des soucis de préparation aux examens pour ceux en fin de formation.
De l’avis des professionnels consultés (qui ont pour la plupart préféré rester anonymes), la part des écoles concernées serait à la fois minoritaire, mais conséquente.
S’il est rare que des écoles exercent sur des pistes totalement « pourries », il semble assez fréquent que les pistes « plateau » posent problème sur au moins un aspect.
Par exemple, nombre des espaces de formation moto, surtout ceux qui sont gratuitement accessibles sur des espaces publics, sont partagés entre plusieurs écoles, ce qui génère parfois des temps d’attente pénalisants pour les élèves.
Autre souci récurrent : dans les grandes agglomérations, l’éloignement des pistes du lieu de garage des motos entraîne des temps de trajet allant de 15-20 minutes jusque parfois 45 minutes aux heures de pointe, à l’aller comme au retour.
« C’est vraiment problématique et participe d’une formation initiale de piètre qualité car cela va entraîner ce que j’appelle l’excuse de circulation : les motards débutants ne sont pas formés sur route parce que l’école considère que le trajet du garage au plateau (et retour) sert de cours de circulation – sur un trajet qui est tout le temps le même, parfois sans liaison radio », explique Stéphane Croci, président de Viaprolearn et formateur de moniteurs moto. « Mais ce temps de trajet est quand même comptabilisé dans les 12 heures de circulation, ce qui fait qu’au final, beaucoup d’élèves suivent au mieux entre deux et six heures de vrais cours de circulation. »
De plus, quand les écoles ne disposent pas d’une piste privée avec rangement sur place, le formateur doit emmener le matériel pédagogique (24 cônes de 20 cm de hauteur, ainsi que 4 piquets d’un mètre et leurs socles), ce qui le contraint le plus souvent à effectuer le trajet en voiture et à prendre du temps pour installer et désinstaller le parcours, et ce à chaque début et fin de cours.
Dans certains cas, sur un cours facturé de trois heures, certains élèves en passent environ la moitié seulement sur la piste, dont encore un tiers à attendre leur tour pour pouvoir effectuer un parcours.
Par ailleurs, le fait de devoir parcourir plusieurs kilomètres sur la voie publique, parfois dans un trafic dense, pose une question de sécurité physique pour les élèves grands débutants et de responsabilité civile pour les formateurs et exploitants.
Chaque année, des accidents plus ou moins graves, parfois causés par l’inconscience de certains moniteurs moto, provoquent des dommages corporels, lesquels peuvent entraîner des poursuites judiciaires au civil, sans compter les dégâts matériels et l’augmentation des primes d’assurance.

Situations de précarité
L’ensemble de ces facteurs de difficulté génère à tout le moins de l’insatisfaction de la part de nombreux élèves parmi les plus de 100 000 candidats aux permis A1 et A2, sans compter les formations sans examen.
Du côté des formateurs et gérants, nombre d’entre eux souffrent de cette situation, notamment du fait de l’insécurité qui entoure cet outil de travail quand ils n’en sont pas propriétaires. Outre les éventuels risques d’envahissement des aires d’évolution par des gens du voyage, la disponibilité de ces pistes « improvisées » n’est jamais garantie sur le long terme.
En 2024, le Conseil départemental du Val-de-Marne a par exemple mis fin sans concertation à la mise à disposition des parkings du parc des Marmousets, utilisés par des écoles moto depuis plus de 20 ans et seul espace gratuitement accessible pour l’enseignement moto dans l’Est francilien. Une trentaine d’écoles locales se trouvent empêchées d’y travailler depuis le 1er janvier 2025, ce qui conduit certaines d’entre elles à cesser leur activité moto et/ou à licencier des salariés.
Des situations comparables au Havre ou à Saint-Pierre de La Réunion mettent en danger d’autres entreprises qui travaillent sur des centres d’examen moto, lesquels vont ou leur ont déjà été interdits. Ailleurs en France, de nombreuses écoles moto exercent dans un cadre précaire, sur des lieux prêtés sans accord écrit par leur propriétaire qui peut alors leur interdire du jour au lendemain l’usage du terrain.
Initiatives locales
Les pouvoirs publics nationaux n’ayant pas vocation à intervenir dans ce domaine, certaines collectivités territoriales ont d’ores et déjà pris des initiatives qui relèvent avant tout de la bonne volonté politique locale.
La mairie de Fréjus met ainsi à disposition de 12 écoles moto une partie du site du marché municipal, accessible du lundi au samedi de 7h à 20h, sauf le jeudi matin (jour de marché). Dans la Sarthe, la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise a financé la réalisation d’une piste moto, inaugurée en novembre 2024 et louée à l’école Saint-Antoine de La Ferté-Bernard pour 120 euros HT par mois.
Dans l’Hérault, le Conseil départemental a réaménagé un tronçon de 1,5 km d’une ancienne route, désaffectée depuis 1981, afin d’y réaliser l’« espace pédagogique 2RM du col de la Cardonille » : ce site unique en France, co-géré par le département et un collectif d’associations motardes, a été inauguré en mai 2023 et est depuis accessible aux écoles de conduite comme aux organismes de perfectionnement post-permis.
Coopération public/privé

Une autre possibilité est d’ouvrir les centres d’examen moto aux écoles, notamment dans les créneaux horaires où aucun examen pratique n’a lieu, comme après 17h en semaine et le samedi.
Cette solution s’est imposée dans certains territoires confrontés à de fortes tensions sur le foncier, notamment dans des zones montagneuses, comme en Haute-Savoie depuis 2023 (pour le centre d’examen d’Annecy) ou encore en Ardèche (à Privas) depuis plus de dix ans.
Entre autres inconvénients, ce type d’arrangement implique une forme de dépendance des établissements envers l’administration, ainsi qu’une concurrence déloyale entre les écoles ayant investi dans une piste privée et celles qui ont un droit d’accès gratuit au centre d’examen, même si les premières bénéficient d’une plus grande liberté et reçoivent généralement plus d’élèves.
Reste qu’au final, cette solution n’est possible que pour les écoles proches de ces centres d’examen, sans oublier qu’elle suppose la mise en place d’un planning partagé, avec un esprit de coopération entre l’administration et les écoles moto, ainsi qu’entre les écoles elles-mêmes.
Mise en commun des moyens
Cette coopération entre écoles de conduite, qui ne va pas de soi dans un secteur économique concurrentiel, apparaît selon de nombreux professionnels comme la meilleure solution à long terme.
Elle permettrait la mutualisation de moyens afin d’acquérir des pistes privées dont les écoles seraient propriétaires et donc indépendantes, pleinement maîtresses de leur avenir. Mobilians-ESR incite par exemple ses adhérents à se regrouper dans des associations d’écoles moto, pour lesquelles l’organisation patronale peut se porter garante et faciliter soit l’achat d’un terrain, soit la mise à disposition par une collectivité locale.
« Avoir une seule piste pile aux dimensions de l’examen n’a pas de sens, car cela oblige à ne faire que du bachotage des parcours d’examen. Quand on connaît les difficultés techniques de l’enseignement moto, il faut au moins une double piste ou une piste simple avec une possibilité d’exercices sur 7-8 mètres de large ou une aire d’évolution carrée de 25 à 30 mètres de côté. Sans cela, ça me paraît compliqué de dire qu’on enseigne la moto dans des conditions de sécurité correctes. », estime Stéphane Croci. « Cela devrait faire partie des conditions d’attribution du label qualité. Deux ou trois petites écoles, qui inscrivent chacune moins de 70 élèves moto par an, pourraient se regrouper pour investir et faire des choses sérieuses avec une piste partagée. »
Des exigences contraignantes
A défaut, seuls les établissements disposant de suffisamment de moyens – et surtout de volonté d’offrir à leurs élèves des prestations de qualité – peuvent se permettre d’acheter une surface suffisante pour y construire l’ensemble des infrastructures nécessaires : non seulement la piste, mais aussi les bureaux et le garage au même endroit.
Tout regrouper sur un seul lieu revêt de nombreux avantages, mais implique des contraintes non négligeables, non seulement en termes de superficie, mais aussi de localisation, d’accessibilité et de nuisances sonores.
On retrouve ainsi la plupart des pistes moto privées en périphérie des villes, loin des zones résidentielles, souvent près d’autres sources de bruit : autoroutes ou voies rapides, aéroports ou aérodromes, circuits de vitesse, zones d’activités ou industrielles… Avec pour avantage des prix du foncier plus abordables pour ces terrains moins recherchés.
Pour autant, ces locaux doivent soit se situer près de stations de transports en commun, soit prévoir des espaces de stationnement suffisamment grands pour accueillir les véhicules des élèves, soit (dans certains cas rares) mettre en place des navettes. Le tout en restant à moins de 30 minutes, voire le plus près possible, du centre d’examen moto. L’ensemble de ces contraintes forme un cahier des charges extrêmement exigeant et coûteux.
Les avantages l’emportent pour les exploitants de ces écoles : disposer de toutes les infrastructures sur place permet d’améliorer le confort pour tout le monde (moniteurs comme élèves), de mieux rentabiliser le temps de formation et au final d’attirer plus de clients. « Cela facilite même le recrutement des formateurs », insiste Philippe Rolland, patron de Moto Conduite à Grenoble : « ils savent qu’ils peuvent s’équiper sur place, se changer s’il se met à pleuvoir, prendre un café chaud, manger, utiliser les sanitaires, prendre une douche en été avant de rentrer chez eux… C’est réellement un autre métier, une autre manière de travailler. »

Encadrés
Les solutions selon Mobilians
L’organisation patronale Mobilians-ESR (éducation et sécurité routières) propose deux pistes de réflexion afin d’améliorer la situation, dans l’intérêt à la fois des écoles et des élèves.
La première vise à inciter les exploitants d’écoles de conduite moto à se rapprocher les uns des autres et à mettre en commun leurs moyens financiers afin d’acquérir des parcelles pour y aménager des pistes partagées.
La seconde consiste à demander à la Direction de la Sécurité Routière (DSR) de rendre obligatoire dans la procédure d’agrément préfectoral une preuve écrite d’accès à une piste aux dimensions réglementaires, que ce soit par un titre de propriété ou un bail locatif ou une convention avec le propriétaire (public ou privé) d’une piste de formation, que cette dernière soit utilisée en exclusivité ou non. Ce passage à l’obligation se ferait avec une période de transition (de l’ordre d’un an ou un an et demi) pour que les établissements aient le temps de se mettre en conformité.

Moto Conduite à Grenoble, Isère
Philippe Rolland a co-fondé en 1984 cette école qu’il gère toujours. Au départ, comme la plupart des autres établissements du secteur, il partait d’un garage en centre-ville pour se rendre sur les parkings du parc des expositions Alpexpo, avec 15 à 20 minutes de trajet. Mais au bout d’une vingtaine d’années, il faut se rendre à l’évidence : « travailler sur une piste éloignée pose une multitude de problèmes ! On s’en contente pendant quelques années, mais il y a un moment où ça devient anxiogène au possible et où on se dit qu’il faut trouver une autre solution. Sauf qu’avec les différentes contraintes administratives, la recherche d’un terrain nous a pris une dizaine d’années… » se souvient-il. En 2011, l’école rachète un ancien hangar frigorifique en bordure d’une voie rapide, dans une zone d’activités toute proche du campus universitaire. Elle réaménage totalement le site pour ne garder que les bureaux et un bout de toiture : « notre objectif était de pouvoir travailler en sécurité avec des élèves de tous niveaux. Le nombre de pistes a été conditionné à la fois par la surface et la disposition du seul terrain que nous avons fini par trouver et par la contrainte du nombre d’élèves puisque le but était de former au moins autant d’élèves qu’avant, donc un minimum de quatre pistes. » Tout a été pensé pour la sécurité des élèves : « nous avons décalé les pistes pour que le demi-tour de l’une ne soit pas au même niveau que le demi-tour de celle d’à côté. Pour cela, il faut avoir une distance suffisante en longueur, au moins 140 à 150 mètres. » Le soin du détail va jusqu’au choix du revêtement des pistes : « notre but était de proposer le même type d’enrobé que sur le centre d’examen, des experts en voirie ont choisi la même granulométrie pour l’enrobé de nos pistes, afin que les élèves soient habitués à la même adhérence, sur sec comme sur mouillé. » Le centre est équipé d’infrastructures rares pour une école moto, comme des lampadaires pour éclairer les pistes en fin de journée l’hiver, un auvent de plusieurs centaines de mètres carrés et un espace d’entraînement aux démarrages en côte : « il nous fallait trouver une solution pour les démarrages en côte car les petites personnes se font facilement mal dans cette situation, donc trouver un moyen de les faire travailler hors circulation. Plutôt que de faire une bosse, nous avons préféré un creux afin de pouvoir travailler avec la personne sans qu’elle risque de basculer et de tomber de haut. » Côté financier, un point est à prendre en compte selon Philippe Rolland : « avec les pistes sur place, les élèves ne perdent pas de temps, donc prennent moins de leçons, notre chiffre d’affaires a baissé de 20%, il nous a fallu inscrire 20% d’élèves en plus pour compenser. » Un objectif largement atteint puisque l’école accueille maintenant deux fois plus d’élèves qu’avant 2012.

Centre de Formation Deux-Roues (CF2R) à Mérignac, Gironde
Thomas Durand a entièrement créé son école en 2012, en s’appuyant sur son expérience de moniteur moto dans un autre établissement voisin, le CFM33.
« Le modèle économique était d’implanter bureaux, parking et garage en bord de piste. Avec cette configuration, cela nous permet de travailler avec des groupes de niveau pour des effectifs jusqu’à six élèves par moniteur. Il m’a fallu six mois de recherches au départ. Mes critères de choix pour un terrain ont d’abord été liés aux dimensions des parcours d’examen, donc pour un terrain d’au moins 130 mètres de long. La principale difficulté a été qu’en général, les terrains de cette dimension sont de forme carrée ou presque, donc surdimensionnés et bien trop chers, alors que nous avons besoin de terrains longs, mais pas forcément larges. La seconde difficulté a été de rester proches du centre d’examen afin de ne pas nous trouver bloqués dans le nombre d’élèves que nous pouvons accueillir et présenter aux épreuves pratiques. J’ai eu la chance de mettre en place la piste avant que n’apparaissent les normes actuelles d’urbanisme sur l’artificialisation des sols et la protection de l’environnement qui engendrent des contraintes et des coûts supplémentaires. De même, je n’ai pas subi de contraintes sur les nuisances sonores car nous sommes dans une zone industrielle. » Il souligne l’importance du raccordement aux réseaux d’eau (approvisionnement et évacuation) dans le cas d’une école 100% moto avec des élèves qui passent plusieurs heures, voire des demi-journées entières, sur place et ont besoin de sanitaires ainsi que de points d’eau pour s’hydrater, surtout en été dans le sud de la France. Rétrospectivement, l’aménagement aurait pu être différent : « pour des raisons de sécurité, il faut plus de 130 mètres de long pour décaler les pistes dans la profondeur ou alors pouvoir les écarter, les séparer les unes des autres. C’est un impératif dont je n’avais pas conscience à l’époque, mais qui me semble être indispensable. » Il donne un conseil à ceux qui voudraient créer une piste : « par habitude, les entreprises d’enrobage fondent leurs devis sur une épaisseur de bitume identique à celle d’une route qui doit supporter le passage des camions de 44 tonnes… sauf que nous n’avons que des motos et quelques passages de voitures ! Cela permet de réduire l’épaisseur d’enrobé, donc la quantité totale de matériau et le coût de réalisation. » Côté sécurité, la priorité pour Thomas Durand est le risque d’envahissement par des caravanes qui doit être contré par un fossé sur tout le pourtour du terrain, avec une barrière dissuasive et/ou un portique à l’entrée. Par ailleurs, la sécurisation des lieux permet de laisser les parcours en place, ce qui fait gagner un temps précieux et représente un atout commercial.

CER 3D à Aoste, Isère
Thierry Letondor gère cinq agences implantées sur trois départements différents (Ain, Isère, Savoie), d’où le nom de son école « 3D », rattachée au CER depuis 2024. Côté moto, il travaille à la fois sur deux pistes partagées, situées en bordure d’un aérodrome, et sur quatre pistes privatives, dont deux en extérieur et deux à l’intérieur d’un ancien hangar industriel, un site unique en France. Il connaît donc les différentes situations que peuvent rencontrer les écoles moto.
« Au départ, j’étais comme tout le monde, j’avais un accord avec une mairie pour une piste aménagée dans une impasse. Mais un jour, la mairie m’a demandé de partir pour faire passer une rocade à cet endroit. J’avais déjà vécu ça trois fois en tant que salarié, donc j’ai décidé d’investir, de me mettre à la recherche d’un terrain. Les contraintes de PLU rendaient impossible l’acquisition d’un terrain nu pour y construire un petit bâtiment. Puis en 2015, j’ai trouvé une usine désaffectée à vendre, avec ce hangar de 4700 m² sans pilier au milieu, sur un site de 1,3 ha que j’ai acheté et aménagé… Nous avons un hangar entièrement clos de 125 mètres de long sur 20 mètres de large, avec dix mètres de hauteur, équipé d’aérateurs comme dans les tunnels pour évacuer les gaz d’échappement et de ballots de paille en bout de piste. Ces pistes indoor permettent aussi de faire d’autres types de formation : poids lourd, CACES, BE, B96… Les pistes extérieures nous permettent de faire travailler les élèves sous la pluie ou au moins sur un revêtement mouillé, afin de les y habituer. C’est très apprécié par les élèves qui peuvent faire du plateau toute l’année, même en cas de pluie ou de neige. Je n’ai pas eu besoin d’augmenter mes tarifs puisque les gains de productivité m’ont permis d’augmenter la clientèle à 600 élèves par an, toutes formations moto comprises. »

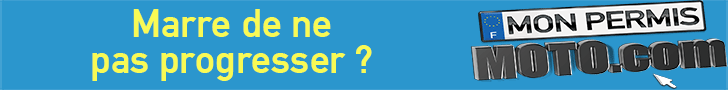
Les pistes souvent le parent pauvre de la formation.
S assurer deja qu elle ne soit pas trop loin de la moto école.
Le mieux ( qui donne souvent le ton de la structure) étant un rdv directement sur la piste car même avec un retard le ensemble du cours ne sera pas perdu.
Ensuite j ai souvent constaté que le revêtement n été pas au top et de nombreuses pistes sont peu abritées hiver comme été.
Au final toujours se renseigner et même aller voir avant de signer le contrat de formation.
A Brive la Gaillarde, 3 pistes utilisables en théorie, mais deux côté à côte sur un lieu qui sert de parking pour les fêtes foraines l’été durant 15 jours .
J’ai passé l’épreuve sur la troisième piste qui penche sur sa largeur et qui n’est pas un modèle de propreté (gravillons) et qui est située face a un quai de chargement poids lourds, donc avec des camions qui manœuvrent juste à côté, il faut parfois interrompre l’exercice pour éviter les risques de Collision. Pas l’idéal !